par Ugo Bellagamba
Tour à tour considérée comme une récréation philosophique, une anticipation technologique, une cousine de l’utopie, ou plus simplement une littérature de genre, la science-fiction est, du point de vue de la temporalité, le fruit d’un subtil métissage : elle explore les futurs en puisant dans le passé, pour parler par allégorie, des enjeux du présent. Rien ne lui échappe et surtout pas la matière historique, à laquelle elle s’abreuve sans cesse et dans laquelle elle puise ses contextes, ses enjeux narratifs, son discours politique, la trame de ses histoires du futur et de ses univers parallèles… Par ricochet, elle contribue à remettre en perspective les événements et les doctrines, les constructions et les crises qui jalonnent l’Histoire des hommes et devient parfois outil épistémologique. La relation entre l’Histoire et la SF a tout d’un contrat aux effets réciproques, et c’est pourquoi, on ne peut appréhender la quintessence de la SF, à la fois prisme déformant et miroir informant de l’Histoire, sans un minimum de culture historique.
— la Science‐fiction, un prisme déformant de l’Histoire
Comme l’affirme Francis Berthelot, la SF est une littérature transgressive, qui brise les barrières génériques dans lesquelles on veut la circonscrire. Irrévérencieuse, serait plus juste encore. La manière dont la SF se sert de l’Histoire fait penser à une chambre d’enfant mal rangée. La matière historique y est éparpillée, puis recomposée en piles instables. Mais, si l’enfant est turbulent, il est également vif. Certaines de ses constructions, dictées par une audace à jamais interdite aux adultes, ont l’éclat de l’inattendu, la pertinence de l’intuitif. Voilà donc la réalité : l’enfant science-fiction joue avec les dix mille cubes de l’Histoire, dans le mépris le plus complet de la chronologie, cet espace de rangement où constitutions et événements devraient être sagement empilés dans la poussière de l’éternité.
Que reproche-t-on au juste à la science-fiction ? D’apprendre en amusant ? Oui, elle brasse pêle-mêle, à travers le prisme déformant de la fiction, le terreau historique des civilisations et toutes les mythologies du monde. Sous la plume des auteurs, l’histoire des cités, des empires et des nations est sans cesse réinventée, au point d’en devenir alternative lorsque la science-fiction se fait uchronie, ou enchantée lorsque la fantasy s’unit au roman historique.
Les exemples sont légion : de « Pavane » de Keith Roberts à « Roma Eterna » de Robert Silverberg, en passant par « Un cantique pour Leibowitz » de Walter Miller, « Le maître du Haut-Château » de Phil Dick, « La Machine à Différences » de Sterling et Gibson, ou encore les « Chroniques des années noires » de Kim Stanley Robinson, l’Histoire est le nectar des auteurs. Elle est présente même dans les œuvres qui ne s’en réclament pas. Sans doute parce qu’elle constitue le plus grand réservoir
de rêves et de cauchemars dans lequel un auteur peut puiser, jusqu’à la noyade. Ainsi, l’histoire de Rome se niche derrière le cycle de « Fondation » d’Asimov, celle de Lawrence d’Arabie se reconnaît dans le « Dune » d’Herbert. Quant aux nombreuses « histoire du futur », oxymore jouissif, d’Olaf Stapledon à Cordwainer Smith, en passant par Robert Heinlein, où trouvent-elles leur substantifique moelle ? Guerres, traités, révolutions, constitutions, restaurations, conspirations... Le kaléidoscope d’avenirs que nous offre la SF est façonné à partir de fragments du passé. C’est un hommage vibrant à nos racines culturelles.
Le caractère mythologique de nombres de récits est une énième preuve de la place prépondérante de l’Histoire, au sens large du terme, dans l’imaginaire des auteurs. Les œuvres de J. R. R. Tolkien, de Roger Zelazny, d’Ursula Le Guin, de Guy Gavriel Kay ou encore de David Gemmel, l’attestent. Combien de fois faudra-t-il assister à la bataille des Thermopyles, à la chute de Carthage, ou à l’épisode de Cheval de Troie pour que tous l’acceptent ? Si la science-fiction était un Parlement d’Ancien Régime, l’Histoire y tiendrait son Lit de Justice à chaque nouvelle publication. Faudra-t-il une séance de la flagellation pour faire admettre aux sceptiques que la SF est aussi proche de l’Histoire qu’elle peut l’être de la Physique ? Littérature transgressive par nature, la SF apparaît comme une récréation historique autant que scientifique.
L’Histoire revêt donc une fonction plurielle dans la SF, puisqu’elle est à la fois une source d’inspiration, un contexte, un enjeu narratif, ou un jeu sur l’évolution du genre, comme l’atteste l’essor du « steampunk », cette variante ludique de l’uchronie. Le « steampunk » revient sur les grandes figures historiques du genre, forgées au cours du long 19ème siècle français et européen. Hommage appuyé aux « maîtres » et à leurs créatures, il met en scène, dans des décors volontiers victoriens, Conan Doyle et Sherlock Holmes, Jack London et Peter Pan, les martiens et la cavorite de Wells, Némo et le Nautilus, démontrant que l’identité de la science‐fiction s’appuie sur des mythes et des valeurs propres. En un mot, qu’elle a su forger sa propre histoire…
— la science-fiction, un miroir informant pour l’Histoire
Au-delà du jeu narratif, il est possible de considérer la science-fiction comme un outil épistémologique qui permettrait de mieux « penser » l’Histoire. Les œuvres qui forment le corpus de la science-fiction, depuis sa naissance sous les plumes de Mary Shelley, Jules Verne et Herbert George Wells, constituent, par l’évolution de leurs thématiques, un « miroir informant » qui nous renseigne sur les valeurs, les peurs et les espérances d’une époque donnée. Et parce que l’utopie elle-même est révélatrice des représentations de l’idéal sociétaire et politique d’un temps, il existe un lien très fort entre elle et la science‐fiction. Le glissement de l’utopie à la SF est matérialisé par l’importance croissante de la science dans le discours utopique, à partir des 17ème et 18ème siècles. Tout d’abord envisagée comme connaissance rationnelle et ensuite appréhendée par ses applications technologiques, la science finit par devenir le moteur de la société idéale. Cette évolution aboutit à la naissance de la science‐fiction au cours du 19ème siècle, à la faveur de la révolution industrielle.
Dans l’entre‐deux‐guerres, la SF oscille entre Nature et Industrialisation ; c’est la critique de la société mécanisée et la nostalgie des sociétés traditionnelles. Citons l’œuvre de Howard Philip Lovecraft qui se réfugie dans le rêve, pour échapper à une société industrielle dans laquelle il ne se
reconnaît pas. Dans les années cinquante, les récits post‐apocalyptiques remettent en cause la toute‐puissance de la science et Hiroshima cloue au pilori tous ceux qui voyaient dans la science la promesse d’un avenir meilleur. La science devient un instrument de destruction.
Dès lors, la SF livre les plus grandes analyses politiques de l’époque, telles le 1984 de Georges Orwell. Dans les années soixante et la décennie suivante, c’est une science‐fiction écologique qui se déploie, aux côtés d’une nouvelle culture prônant la libération sexuelle et l’usage des psychotropes. C’est l’époque de Ballard et de Dick, de l’exploration paranoïaque des univers intérieurs qui témoigne d’un certain rejet de la société. Une science‐fiction très politique, très sociale voit le jour,
inaugurée par Tous à Zanzibar de John Brunner et continuée par Les Monades urbaines de Robert Silverberg, et Soleil Vert de Harry Harrison. Les années quatre‐vingt, quant à elles, sont globalement une phase « en creux » pour la science‐fiction qui se replie sur la pure évasion et voit la montée en flèche de la fantasy commerciale. La critique, de sociale, devient comportementale. Le sport envisagé comme guerre, par exemple dans La guerre olympique de Pelot. Ou l’impact des réseaux informatiques sur la vie quotidienne des individus, qui donne naissance à un nouveau courant, narcissique et violent, le « cyberpunk ». La fin du vingtième siècle est, à l’instar de la société
pluriculturelle qui voit le jour, celle d’une science‐fiction composite. Avec un retour en force du « vivant » comme enjeu narratif, les romans fondés sur l’ingénierie génétique se multiplient, explorant le thème des mutations et du clonage. Mais la SF réinvestit aussi les territoires de la « culture » et puise sans retenue dans l’Histoire, multipliant les uchronies. Le cycle de la Culture de Iain Banks allie ainsi brillamment critique sociale et space‐opera démesuré. C’est enfin l’émergence du « steampunk », du jeu sur l’histoire du genre en lui‐même.
Au vingt‐et‐unième siècle, la SF continue de refléter les transformations sociales et les incertitudes de la géopolitique. Elle porte la marque des avancées scientifiques et technologiques (exoplanètes, nanotechnologies). Etroitement liée au contexte ambigu d’un monde multipolaire, cette science-fiction se caractérise par un foisonnement thématique. Sa subtilité croissante témoigne, outre d’une cristallisation du genre, de la calcification des concepts politiques, tels que l’État‐Nation ou la souveraineté. Plus ambitieusement encore, la SF part à la recherche de nouveaux paradigmes.
S’il apparaît évident que l’Histoire est dans la science-fiction, la SF est également « dans » l’Histoire, puisqu’elle témoigne des enjeux de deux siècles, qu’elle distille par métaphores. D’où la nécessité, pour le lecteur, de disposer d’une certaine culture historique.
— la culture historique du lecteur de science‐fiction
Certains chercheurs se demandent aujourd’hui quelle est l’étendue de la culture scientifique d’un lecteur de SF, supposant qu’il doit en posséder une pour accéder à la compréhension de l’œuvre. Il semble encore plus pertinent de se demander quelle devrait être sa culture historique. La grande majorité des œuvres de SF, sans même parler du cas particulier de l’uchronie, n’est véritablement jouissive que pour ceux qui disposent des clefs pour l’appréhender. Tentez de lire « Le printemps russe » de Spinrad sans connaître, au moins dans ses grandes lignes, l’histoire de l’U.R.S.S. et de la
C.E.I. ou plongez‐vous dans « Autant en emporte le temps » de Ward Moore, sans connaître les grandes lignes de la Guerre de Sécession. C’est comme si vous lisiez les cent uchronies consacrées à Napoléon sans savoir que Waterloo n’est pas une victoire éclatante pour les armées impériales ; comme si vous découvriez les « Chroniques des Années Noires », le dernier roman de Kim
Stanley Robinson, sans rien savoir du Moyen‐Âge et de l’essor du christianisme. Et, bien qu’il ne s’agisse pas véritablement d’histoire, on peut évoquer une lecture naïve de Tolkien sans la maîtrise des grandes mythologies dont il s’inspire, celle arthurienne, celle scandinave, celle celtique, etc. Comment comprendre que la mort de Boromir est un hommage à celle de Roland à Roncevaux, si on ne sait rien de cette dernière ? Comment apprécier la thématique de l’Anneau et la cape d’invisibilité de Frodon (voire celle, plus récente, d’Harry Potter) si on n’a jamais entendu parler de Siegfried
et du Lai des Nibelung ? D’où le paradoxe qui mine la science‐fiction. Elle a l’ambition avouée de
s’adresser à tout le monde et n’est pourtant pas, dans sa quintessence, une littérature de masse. Elle l’est moins, en tout cas, que d’autres littératures prétendument « générales » et généralement arrogantes à l’égard des « genres », qui ne réclament aucune espèce de préparation pour être
appréciées.
La SF, que l’on a trop souvent considérée comme atrophiée du point de vue de la culture serait‐elle, en définitive, une littérature hermétique ? Nécessiterait‐elle une propédeutique qui garantirait à la fois sa force thématique et constituerait sa faiblesse congénitale ? Il faut nuancer ce propos, bien sûr. Si la SF exige sans doute certains efforts de la part des lecteurs, elle n’est pas non plus ésotérique et n’a nulle vocation à l’être. Ceux qui le croient ne contribuent qu’à la « ghettoïser » un peu plus. Elle est et doit rester une simple récréation, philosophique, scientifique, et en l’espèce, historique. Mais, comme dans toutes les cours de récréation, il faut avoir des jouets pour s’amuser ou, tout au moins, posséder assez d’imagination pour en créer. Seule la science‐fiction peut transformer une corde à sauter en ruban de Möbius, ou une roue de vélo en station spatiale… Paul Valery, qui avait tout compris à la science‐fiction sans le savoir, n’affirmait‐il pas : l’étude de l’Histoire n’a de sens que pour ceux qui ont la passion de l’avenir ?
Ugo Bellagamba.
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)



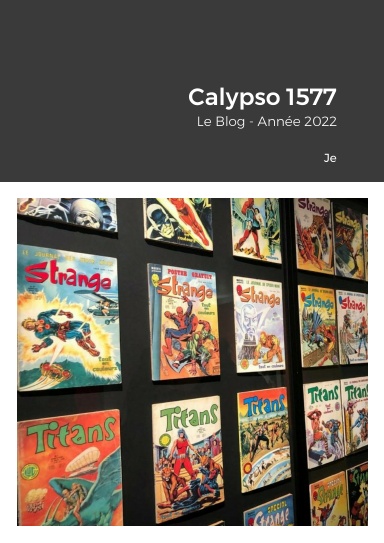
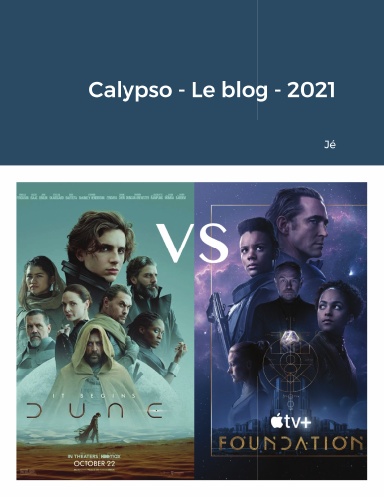
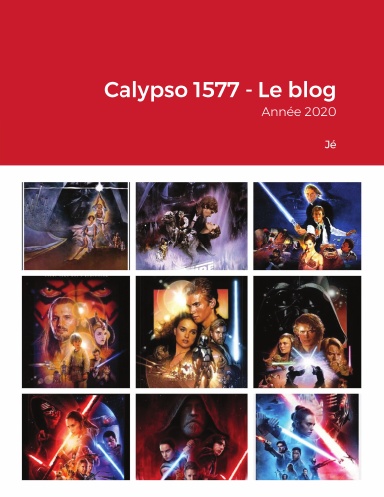












Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire